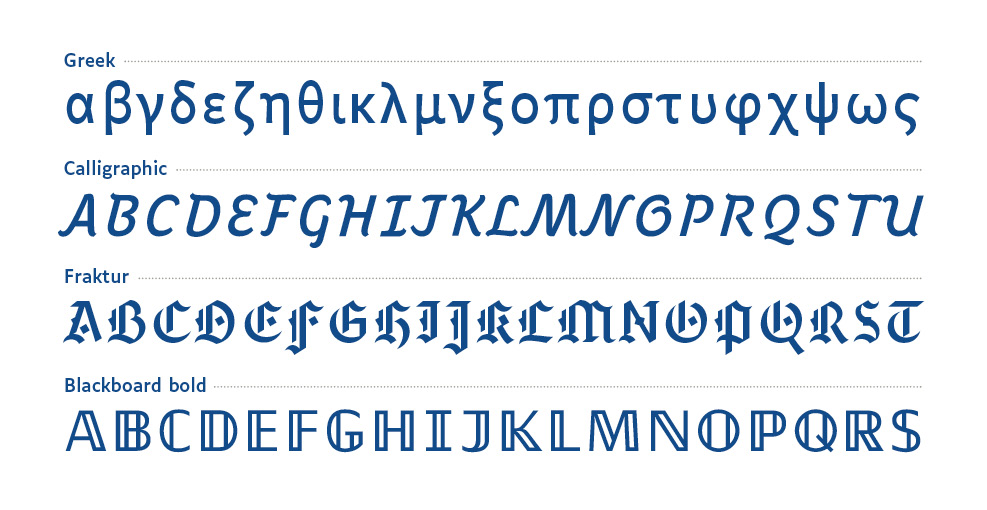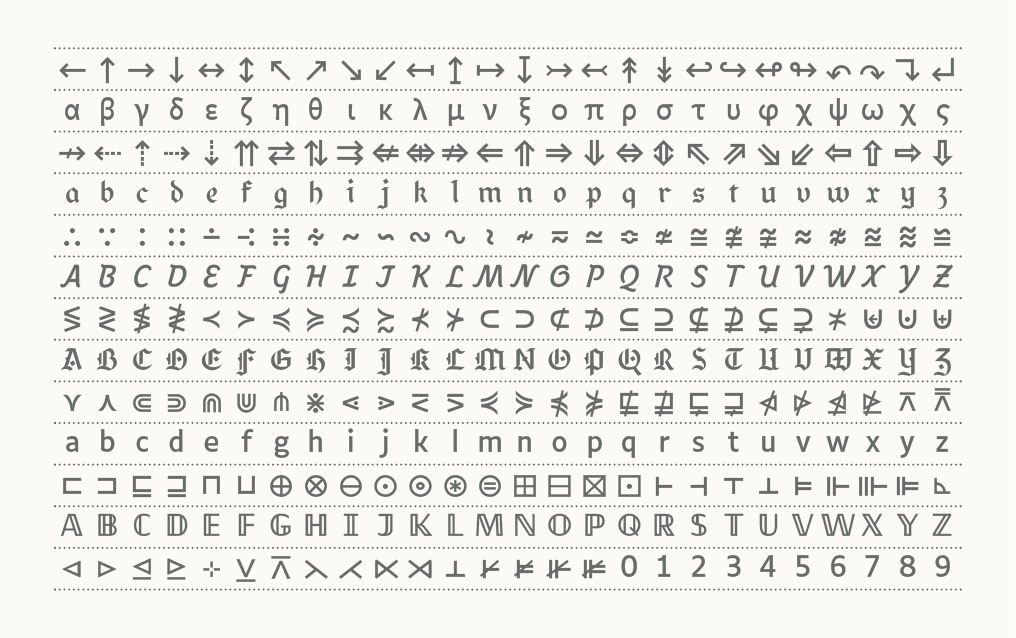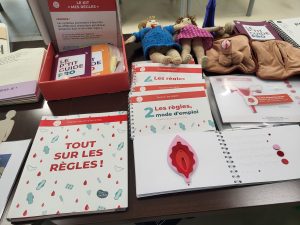Table des matières
INTRODUCTION
TOUR DE TABLE
PRÉSENTATION DU GROUPEMENT D’INTÉRÊT PUBLIC MUSÉE LOUIS BRAILLE
BRAILLE EN PÉRIL, QUELLES SOLUTIONS ?
PRÉSENTATION DU CADRE DE LA CANDIDATURE À l’UNESCO
LE BRAILLE PORTÉ VERS L’UNESCO PAR SA COMMUNAUTÉ
SYNTHÈSE
INTRODUCTION
L’objectif principal de cette réunion du 10 mars 2025 est de préparer la candidature de l’apprentissage et de l’usage du braille pour une inscription au patrimoine culturel immatériel de l’humanité auprès de l’UNESCO, le braille ayant déjà été inscrit à l’inventaire national du patrimoine culturel immatériel français le 13 juin 2023, grâce au travail mené par Joël Hardy, retraité ministériel et docteur en sciences de l’éducation, promoteur événementiel de l’œuvre de Louis Braille depuis 2010.
Cette rencontre marque un tournant dans la démarche de reconnaissance du braille, avec un projet ambitieux et structuré, réunissant divers acteurs publics et associatifs pour préserver l’héritage de Louis Braille et promouvoir son œuvre au niveau mondial.
TOUR DE TABLE
Nombre d’acteurs investis dans le domaine du braille et de la déficience visuelle sont présents, parmi lesquels la Direction Générale de la Cohésion Sociale (DGCS), l’INSEI (Institut National Supérieur pour l’Éducation Inclusive), l’INJA (Institut National des Jeunes Aveugles), le GIP (Groupement d’Intérêt Public) Musée Louis Braille, ainsi que des élus de la commune de Coupvray.
Plusieurs associations nationales sont également représentées : Voir Ensemble, la Fédération des Aveugles et Amblyopes de France (FAAF), la Confédération Française pour la Promotion Sociale des Aveugles et Amblyopes (CFPSAA), l’Union Nationale des Aveugles et Déficients Visuels (UNADEV), l’Association Valentin Haüy (AVH), l’Association Nationale des Parents d’Enfants Aveugles ou Malvoyants (ANPEA), l’Association des Transcripteur-Adaptateurs Francophones (ATAF), ainsi que le Centre de Transcription et d’Édition en Braille (CTEB).
PRÉSENTATION DU GROUPEMENT D’INTÉRÊT PUBLIC MUSÉE LOUIS BRAILLE
PAR THIERRY CERRI, MAIRE DE COUPVRAY
La candidature du braille au patrimoine culturel immatériel de l’humanité est une démarche collective qui ne doit pas être vue comme le travail d’une seule organisation, mais comme un projet qui appartient à toute la communauté du braille. Le braille est en effet un bien commun à tous ceux qui l’utilisent, l’enseignent, l’apprennent et le transmettent, il appartient à l’humanité tout entière. Il est l’héritage laissé par Louis Braille, génie de l’équité, dont l’invention permet depuis 200 ans aux personnes déficientes visuelles de retrouver leur dignité .
La commune de Coupvray est le berceau de Louis Braille et de l’engagement pour la préservation de son héritage, notamment à travers la création du groupement d’intérêt public (GIP) du musée Louis Braille. Ce GIP, qui regroupe la commune et la Fédération des Aveugles et Amblyopes de France (FAAF), vise à préserver l’histoire du braille et à promouvoir son devenir. Le musée, fondé en 1958, est au cœur de cette initiative, et le GIP s’emploie à moderniser cet espace.
En parallèle, le GIP souhaite aller au-delà de la simple préservation et devenir un centre de diffusion et de promotion du braille. Des ateliers d’écriture braille sont déjà mis en place et le GIP projette de structurer davantage ses actions en multipliant les partenariats avec des acteurs locaux, régionaux et nationaux. Avec la volonté de moderniser cet héritage et de le faire connaître à un large public, notamment à travers la création d’un circuit muséal. La région, l’intercommunalité et le département ont déjà montré leur soutien, et plusieurs autres acteurs sont en discussion pour rejoindre le projet.
Le GIP a récemment obtenu des financements de diverses institutions pour la réhabilitation du musée Louis Braille, il a pour projet dans un futur proche de préparer le bicentenaire du braille en 2025, avec une grande journée de sensibilisation.
Un travail de collaboration internationale doit en outre se mettre en place pour soumettre le dossier du braille à l’UNESCO, avec l’espoir de lui voir obtenir une place méritée au sein du patrimoine mondial.
BRAILLE EN PÉRIL, QUELLES SOLUTIONS ?
Tour de paroles
Voir Ensemble : Le déclin de l’apprentissage du braille est inquiétant, notamment dans les pays en développement, il pourrait entraîner une génération d’analphabètes parmi les personnes aveugles et malvoyantes. Il est fondamental de savoir lire et écrire pour l’autonomie. Le braille évolue avec les nouvelles technologies, notamment l’émergence d’écrans tactiles en relief qui pourraient révolutionner son usage en permettant une lecture en deux dimensions plutôt qu’en ligne à ligne. Une adaptation de la formation pour intégrer ces innovations et une politique de promotion des nouvelles technologies dans ce domaine seraient bienvenues.
La Fédération internationale des professeurs de français : L’Amérique latine est en avance sur ces questions et intègre la sensibilisation à travers ses congrès régionaux. Beaucoup de professeurs de français, bien qu’engagés, manquent de formation et de moyens pour inclure les élèves déficients visuels. Le 16ème congrès mondial de la Fédération internationale des professeurs de français se tiendra à Besançon du 10 au 17 juillet, avec plus de 3 000 enseignants, Joël Hardy y interviendra pour répondre à des questions pratiques au sujet de braille.
Le CTEB : Le braille papier a une importance fondamentale. Le rôle du toucher est essentiel pour l’apprentissage et la mémorisation. Il est aujourd’hui encore nécessaire de lutter pour l’accès aux supports en braille. Le combat du CTEB est de produire et vendre des livres en braille au même prix que les ouvrages en librairie, grâce à un modèle économique qui reste viable pour l’instant. Il milite également pour une évolution de la loi Lang afin d’y inclure le braille et ainsi en garantir un prix unique et abordable. Le braille numérique est devenu incontournable mais on ne doit pas oublier la valeur du papier, tant pour l’apprentissage et le plaisir du toucher que pour celui de posséder un livre physique. La qualité du braille imprimé est elle-même essentielle, avec plusieurs aspects techniques :
-
La qualité du papier et de l’embossage pour assurer une lecture fluide et agréable.
-
L’utilisation du vernis braille.
-
L’Évolution des technologies, notamment avec l’intelligence artificielle pouvant faciliter la description des images en braille et d’autres aspects de l’accessibilité.
Il est en tout cas nécessaire de préserver une production papier, notamment pour les médiathèques francophones et les lecteurs individuels. L’opposition entre braille numérique, braille papier et audio n’a par ailleurs aucun sens, tous les formats sont complémentaires et doivent être maintenus pour répondre aux différents besoins des personnes non-voyantes.
L’INSEI : le rôle de la formation de l’Institut National Supérieur d’Enseignement et de recherche pour l’Inclusion est crucial, il propose notamment un master en enseignement et déficience visuelle. Ce programme, qui inclut la mastérisation du CAEGADV, est destiné à former les professionnels de l’éducation spécialisés dans ce domaine. Cependant, la formation au sein de l’Éducation nationale demeure une inquiétude majeure. En effet, cette année, seulement un enseignant sur le CAPPEI (Certificat d’Aptitude Professionnelle aux Pratiques de l’Éducation Inclusive) et six professionnels de l’Éducation nationale suivent cette formation spécifique en enseignement et déficience visuelle pour toute la France. Cela soulève la problématique de formation insuffisante pour répondre aux besoins croissants dans ce secteur. On déplore le déficit d’enseignants spécialisés en troubles de la fonction visuelle, phénomène qui touche l’ensemble de l’Éducation nationale.
Bien qu’il y ait une formation de qualité pour les enseignants spécialisés, ceux-ci ne bénéficient pas toujours du temps nécessaire pour un enseignement spécialisé adapté. La loi de 2005 est à ce sujet paradoxale : on ferme les internats tout en réduisant le nombre d’enseignants spécialisés, ce qui met en difficulté l’accompagnement des élèves déficients visuels dans des classes nombreuses.
La formation dispensée par l’INSEI met l’accent sur la complémentarité des supports d’apprentissage (braille papier et numérique), qui sont facilitants pour l’insertion professionnelle.
Le rapprochement croissant entre l’Éducation nationale et le secteur médico-social est enthousiasmant et il pourrait améliorer la couverture des besoins des élèves dans le cadre de l’école inclusive.
La Fédération des Aveugles de France soutient le musée du braille depuis les années 50 avec un financement annuel d’environ 50 000 euros. Une action unique et essentielle pour la pérennité du musée.
L’école inclusive fait partie des défis actuels de notre société, elle permet aux enfants malvoyants ou aveugles d’apprendre près de chez eux, mais il manque trop de professeurs et d’instructeurs spécialisés dans le braille. L’absence de ces professionnels risque de mener à un retard scolaire pour les enfants aveugles, rendant leur parcours éducatif difficile. L’Éducation nationale doit donc se mobiliser pour former davantage de professionnels du braille afin de garantir un enseignement de qualité pour tous les élèves.
Benjamin Mathieu, chercheur en neurosciences, mène son projet de recherche sur le plaisir du toucher et son impact sur l’apprentissage du braille. Il collabore avec l’imprimerie Laville pour tester l’acuité tactile braille sur différentes surfaces, en partant de l’hypothèse qu’une texture agréable peut faciliter l’apprentissage. Il compte valider cette idée par des expérimentations. Son projet vise aussi à promouvoir l’utilisation du braille en s’appuyant sur son expérience personnelle. Atteint de rétinite pigmentaire, il a appris le braille jeune sans en percevoir immédiatement l’utilité. Avec l’aggravation de sa maladie, il a pris conscience du risque d’analphabétisme lié à la perte de la vision. Son projet cherche donc à lutter contre cet illettrisme et à démontrer que le braille reste indispensable pour les non-voyants dans la société actuelle.
PRÉSENTATION DU CADRE DE LA CANDIDATURE A l’UNESCO
PAR LILY MARTINET, DU MINISTÈRE DE LA CULTURE
Cette démarche a pour objectif une reconnaissance internationale, au-delà de la France. La Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel régit ces démarches, et la liste représentative du patrimoine culturel immatériel est l’instrument le plus pertinent pour cette candidature, en tant que vitrine mondiale de la diversité des pratiques culturelles. Le braille, bien que distinct des pratiques déjà inscrites, bénéficie de cette opportunité, mais la reconnaissance nécessite une coopération internationale. Une organisation au niveau national pour coordonner les parties prenantes est importante pour y parvenir, en particulier en France, le ministère de la Culture accompagne le processus sans en être l’initiateur.
L’Allemagne ayant déjà inclus le braille dans son inventaire, elle pourrait se joindre à la France pour une candidature multinationale. Cela nécessiterait une coordination entre les différentes acteurs en France et un partenariat avec l’Allemagne. Le GIP pourrait jouer un rôle de facilitateur dans ce processus, afin d’assurer une représentation équilibrée et cohérente de la communauté patrimoniale. Il est crucial de garantir une participation large et représentative des communautés patrimoniales et d’avoir des démarches transparentes.
Une candidature UNESCO a des aspects concrets comme le formulaire ICH-02, qui doit être rempli en coopération avec les autres États participants. Il est également nécessaire de réaliser un film de candidature et des photographies pour illustrer la démarche, tout en prenant en compte les droits d’auteur, l’UNESCO impose des règles strictes sur la manière de les produire. Il est la possible d’ajouter des éléments relatifs au développement durable, et il serait important d’envisager l’impact du braille dans ce domaine.
LE BRAILLE PORTÉ VERS L’UNESCO PAR SA COMMUNAUTÉ
Procédure et perspectives
Début de la démarche : Voir Ensemble se demande si le dossier est prêt pour être déposé et quelles informations ou pièces doivent être fournies. Le GIP évoque la réalisation d’un document préparatoire, dans la continuité des démarches déjà amorcées pour une reconnaissance nationale du braille. L’idée serait de finaliser le dossier pour mars 2026. Un questionnaire doit être partagé pour collecter les informations auprès des différents acteurs.
Délais de procédure : Lily Martinet indique que les délais pour l’instruction du dossier sont longs. Après le dépôt en mars, il y a un contrôle de complétude qui dure six mois. Ensuite, un délai supplémentaire est accordé pour compléter le dossier. L’évaluation par un organe de 12 experts internationaux prend près d’une année. Ainsi, une inscription prévue en mars 2025 comme celle-ci pourrait être effective en décembre 2026.
Coordination et gestion du projet : Le GIP (Groupement d’intérêt public) a été désigné comme coordinateur pour ce projet, avec la responsabilité de gérer l’organisation et de faciliter la communication entre les différents acteurs impliqués. Un calendrier de candidature a été proposé, avec des réunions régulières pour assurer le bon déroulement du projet. Le GIP devra s’assurer que les informations sont bien partagées et que toutes les parties prenantes travaillent ensemble de manière cohérente.
Consensus et feuille de route : Un état des lieux préalable doit être réalisé pour parvenir à un consensus sur les objectifs du projet. Les participants doivent réfléchir à la meilleure manière de structurer leur contribution, en s’appuyant sur les documents déjà rédigés et les propositions qui émergeront au fil des réunions.
Formulaire et candidature UNESCO : Le processus de candidature nécessite de remplir un formulaire complexe, que les participants devront examiner attentivement. Le formulaire sera accompagné de ressources et d’exemples fournis par le ministère de la Culture pour guider les parties prenantes. Lily Martinet souligne que l’objectif n’est pas simplement de remplir un formulaire, mais de garantir que la candidature soit soutenue par des mesures concrètes de sauvegarde et un travail de collaboration avec les autres pays, notamment l’Allemagne.
Soutien et participation des membres : Voir Ensemble questionne le ministère de la Culture sur l’importance de la participation des membres pour soutenir la démarche, notamment en apportant des lettres de soutien ou des témoignages d’adhérents et de bénéficiaires. Lily Martinet explique que la participation consiste à réagir aux contenus du formulaire et à proposer des ajouts. La communauté doit définir les mesures de sauvegarde pour le braille, une section essentielle du dossier.
Méthode de travail pour le dossier : Joël Hardy partage son expérience dans la préparation d’un dossier de reconnaissance nationale, soulignant que l’élaboration doit venir de la communauté du braille elle-même. Il recommande de commencer par informer et faire émerger des idées de la part des volontaires, puis de répondre de manière concise et précise aux questions du formulaire dans le cadre du dossier.
Rôle des participants : Les participants, comprenant des associations, des chercheurs et des institutions gouvernementales, ont exprimé leur volonté de participer activement à ce projet. Ils devront apporter des contributions spécifiques, en fonction de leurs domaines d’expertise. Chaque structure désignera un représentant pour être le lien avec le GIP, afin de faciliter les échanges et la coordination.
Mesures de sauvegarde et législation : La question des mesures de sauvegarde a été discutée, en lien avec les obligations gouvernementales, notamment en ce qui concerne la formation des enseignants spécialisés en déficience visuelle. Il a été rappelé que le braille est inscrit dans la Convention des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées, ce qui pourrait renforcer la légitimité du projet.
Rôle de l’État et mesures de sauvegarde : L’État soutient déjà des mesures de sauvegarde, mais c’est la communauté qui doit établir son propre plan et assurer le suivi. Les États participants à une candidature multinationale peuvent également proposer des mesures de sauvegarde à plus grande échelle.
Exemples de candidatures réussies : Lily Martinet cite des exemples d’éléments inscrits au patrimoine immatériel, comme la culture foraine franco-belge et l’art de la construction en pierre sèche. Le ministère de la Culture précise que les candidatures multinationales permettent l’extension de l’inscription à d’autres États après la première soumission. Il est cependant très compliqué de commencer la procédure avec plusieurs états et préférable de les intégrer par la suite.
Proposition d’extension de la candidature : Lily Martinet mentionne qu’un dossier peut commencer avec un nombre limité d’États, mais d’autres pays peuvent rejoindre la candidature à l’avenir, sous certaines conditions (ratification de la Convention et inclusion du braille dans l’inventaire national de ces pays). Le GIP évoque l’importance de la reconnaissance du braille à l’échelle internationale et interroge sur la possibilité de solliciter d’autres pays européens, comme le Royaume-Uni. ATAF suggère de commencer avec des pays francophones pour faciliter la coopération. Lily Martinet répond que le Royaume-Uni a récemment ratifié la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, mais n’a pas encore de procédure pour inclure des éléments dans l’inventaire national. En revanche, l’Allemagne a déjà inclus le braille et des contacts sont établis avec ce pays pour le projet.
Langue de travail : La question des langues a été soulevée, avec une préférence pour l’anglais et le français. Les participants devront travailler principalement en anglais, surtout en collaboration avec les Allemands.
Coordination des actions en faveur des jeunes déficients visuels et évolution du braille : La DGCS rappelle qu’il est essentiel de veiller à la cohérence entre les propositions issues de la démarche actuelle et les politiques déjà en cours ou à venir. Certains ajustements sont envisageables, mais ils doivent rester organisés et réalistes, afin de ne pas fragiliser un système déjà peu solide. L’idée est d’envisager un « choc élastique », c’est-à-dire une transformation souple mais structurée.
Concernant l’enseignement du braille, il ne s’agit pas de créer un corps de « professeurs de braille », mais de renforcer la présence d’enseignants certifiés par un diplôme d’État, spécialisés dans l’enseignement adapté aux jeunes déficients visuels. Pour cela, un renfort est nécessaire, notamment pour justifier la demande de moyens supplémentaires. La coordination avec l’Éducation nationale reste un chantier permanent.
Une recommandation de bonnes pratiques est attendue de la part de la Haute Autorité de santé, visant à harmoniser les commissions qui préconisent l’apprentissage du braille pour les jeunes concernés. Ce travail est essentiel dans le cadre des réflexions sur l’évolution du braille français. Une commission dédiée à ce sujet sera relancée pour améliorer le code braille dans son ensemble.
Enfin, une évaluation est en cours sur l’édition adaptée accessible, assurée par l’IGAC et l’IGAS, afin de soutenir la filière de transcription et d’adaptation. Ces différents chantiers doivent être menés de manière concertée. Le rôle du ministère des Affaires sociales et de la Santé est d’accompagner ce processus, tout en veillant à la fiabilité scientifique et réglementaire des informations mobilisées.
Conclusion
Il reste donc encore beaucoup à faire pour préparer le dossier de reconnaissance du braille, avec une coopération active entre les différentes parties prenantes et une attention particulière aux mesures de sauvegarde proposées par la communauté elle-même. Le soutien de l’État est à cet égard essentiel pour en assurer la réalisation.
Cet échange marque le début d’une collaboration structurée pour l’inscription du braille au patrimoine immatériel de l’UNESCO. L’objectif est de travailler ensemble, de manière coordonnée sous la responsabilité du GIP pour mener à bien cette candidature, tout en s’assurant que les actions de sauvegarde entreprises seront à la fois réalistes et concrètes.
SYNTHÈSE
Cette réunion a été un moment de réflexion et de coordination très important pour préparer la candidature du braille au patrimoine immatériel de l’UNESCO. Les discussions mettent en évidence une volonté de rassembler une diversité d’acteurs, allant des associations aux chercheurs, en passant par des experts gouvernementaux, afin d’organiser un dossier solide. L’accent est mis sur l’importance de la coopération, du travail en équipe et d’une bonne organisation pour éviter de se perdre dans la bureaucratie.
Les participants ont abordé plusieurs aspects, notamment la définition du rôle de chaque acteur, les responsabilités du GIP en tant que coordinateur, et les étapes concrètes à suivre pour mener à bien ce projet. Le fait que le dossier ne soit pas simplement une formalité administrative, mais un travail de réflexion approfondi sur l’avenir du braille, montre qu’il y a un réel engagement nécessaire pour garantir la réussite de cette candidature.
L’idée de créer une feuille de route avec des objectifs clairs et des délais précis semble cruciale pour maintenir l’engagement de tous et pour éviter toute dispersion. De plus, l’intégration de plusieurs pays, comme l’Allemagne et le Portugal, renforce la dimension internationale de la démarche, et la question linguistique (travail en anglais) est bien prise en compte.
Il est également évident que ce projet nécessite une préparation minutieuse, avec un travail de fond sur la documentation et une gestion rigoureuse des rôles de chacun. L’enjeu est de taille, car il s’agit non seulement de préserver le braille, mais aussi de sensibiliser un large public à son importance dans l’autonomie des personnes déficientes visuelles.
La réunion reflète aussi une tension entre la nécessité d’un consensus sur les actions à mener et la complexité du dossier administratif. Les préoccupations sur la coordination des actions et sur l’efficacité des mesures de sauvegarde sont légitimes, surtout dans un cadre aussi vaste.
Il s’agit donc d’un travail collectif ambitieux qui, s’il est bien mené, pourrait avoir un impact considérable pour la préservation du braille à l’échelle mondiale.
ATAF s’engage à soutenir le projet d’inscription au PCI de l’humanité de l’apprentissage et de l’usage du braille et désigne un représentant pour participer aux réunions.
Si vous voulez vous-même participer à ce projet, vous pouvez prendre connaissance des deux documents ci-dessous, et nous retourner par mail vos réponses aux questions à cette adresse : contact@transcripteur.fr
ICH-02-2026-FR-doc-de-travail-individuel
Formulaire-question-reponse-UNESCO